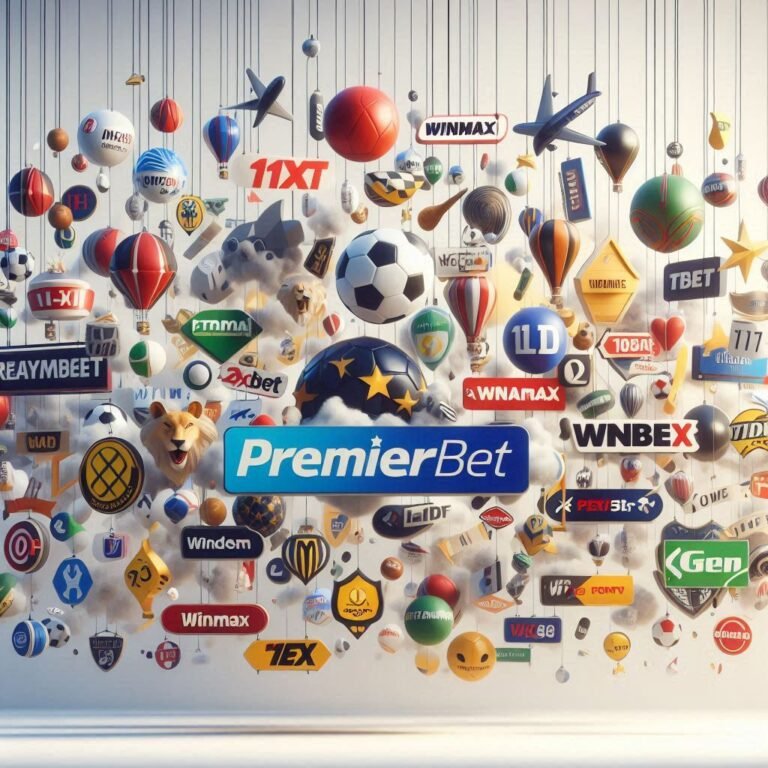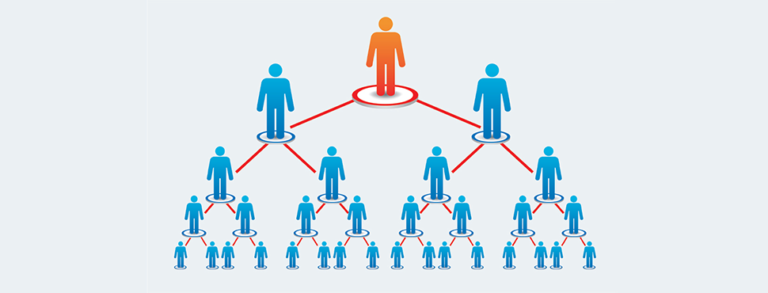Problématique sur la pertinence des vaccins antipaludiques
Alors que les campagnes de vaccination antipaludique se multiplient en Afrique, le débat sur leur pertinence persiste malgré des résultats encourageants. Dans un reportage diffusé sur Vox TV, le Docteur Antoine Loussambou, Directeur du Programme National de Lutte contre le Paludisme, a soutenu que « Le vaccin n’immunise pas totalement, mais il renforce le système immunitaire pour éviter les formes graves. » Une nuance cruciale qui interroge la logique même de ces campagnes massives.
Un vaccin, selon l’OMS, est une préparation conçue pour stimuler les défenses immunitaires contre un agent pathogène spécifique. Il entraîne l’organisme à produire des anticorps et des cellules mémoire, créant une immunité durable sans provoquer la maladie. Cette définition cadre mal avec les vaccins antipaludiques RTS,S et R21, dont l’efficacité oscille entre 50 % et 75 % selon les protocoles, nécessitant quatre doses et des rappels réguliers.
Le Dr Loussambou insiste sur un point : ces vaccins ne bloquent pas l’infection, mais atténuent sa gravité. Une approche qui s’apparente davantage à une immunomodulation qu’à une immunisation classique. Cette distinction soulève des questions éthiques et pratiques. Pourquoi déployer des campagnes coûteuses pour un résultat partiel ? La réponse réside dans l’urgence épidémiologique : avec 94 % des cas mondiaux concentrés en Afrique et un enfant mourant chaque minute du paludisme, même une protection imparfaite peut sauver des vies.
Les critiques pointent une communication parfois excessive, martelant l’idée d’une « solution miracle » là où les vaccins ne sont qu’un outil complémentaire. Pourtant, leur synergie avec les moustiquaires imprégnées et les traitements préventifs saisonniers (CPS) a démontré une réduction jusqu’à 75 % des cas cliniques. L’enjeu n’est donc pas de choisir entre vaccination et autres méthodes, mais de conjuguer leurs effets.
Reste l’épineuse question des risques à long terme. À l’image des vaccins anti-COVID-19, accusés de provoquer des effets inconnus, les antipaludiques suscitent des craintes. Les essais cliniques rigoureux menés depuis des décennies n’ont pourtant officiellement révélé aucun danger grave, et leur mécanisme, à savoir le ciblage spécifique des protéines de sporozoïtes limite les risques de réactions imprévues. Les « désagréments » redoutés relèvent davantage de la méconnaissance que de données scientifiques publiées.
Faut-il se faire vacciner ? Dans les zones endémiques, les autorités sanitaires recommandent la vaccination, tout en soulignant la nécessité de maintenir les autres mesures de prévention. Cependant, la décision finale appartient à chacun, pour soi-même comme pour ses enfants. Personne ne devrait se sentir obligé de se faire vacciner contre le paludisme s’il ne le souhaite pas ou s’il n’est pas convaincu par l’efficacité du vaccin. Attendre un vaccin parfait n’est pas une option sans conséquences, mais le choix de se faire vacciner ou non doit rester libre, fondé sur une information claire et sur la conviction personnelle.